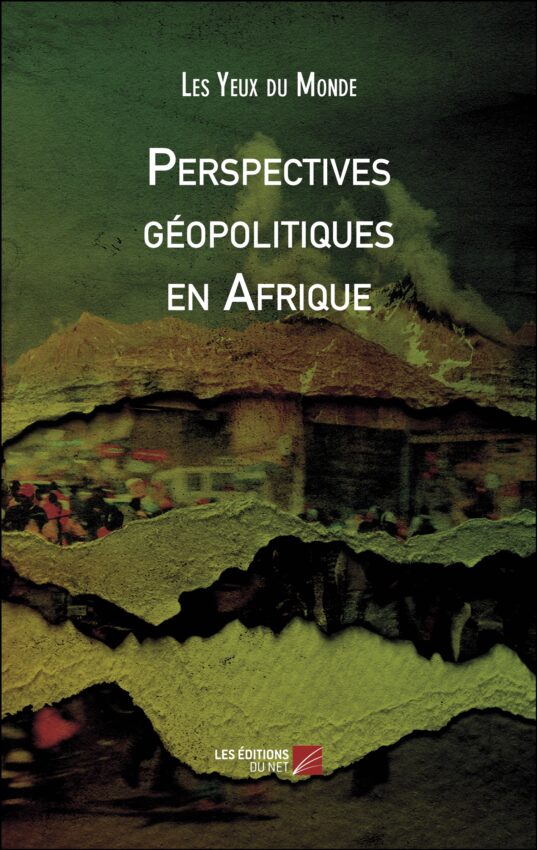Entretien : les règlements des différends frontaliers en Amérique latine (3/3)
Publié en mars 2025 aux éditions Mare & Martin, l’ouvrage collectif Règlement des différends frontaliers en Amérique latine propose une analyse approfondie des mécanismes de résolution des litiges territoriaux dans la région. Sous la direction de Jean-Baptiste Busaall, Maître de conférences en Histoire du droit à l’Université Paris Cité et de Nathalie Clarenc, Maître de conférences en droit public à l’Université Paris Cité, il offre une lecture croisée d’arbitrages frontaliers historiques ou contemporains issus d’une sélection de cas emblématiques latino-américains. Parmi les contributeurs, Claire de Blois, Maître de conférences en Histoire du droit et des institutions à l’Université d’Orléans, consacre sa contribution au différend frontalier entre la Guyane française et le Brésil.
Quels sont les moyens et pouvoirs mis à disposition des arbitres pour instruire un différend frontalier et parvenir à une décision ? Comment les conclusions arbitrales sont-elles généralement perçues, tant par les États concernés que par leurs opinions publiques, ou encore, les États tiers impliqués au sein du litige ?
J.B.B. : L’accueil des arbitrages rendus par des chefs d’État étrangers dépend réellement du contexte. L’ouvrage donne un exemple de réussite dans le différend entre le Venezuela et les Pays-Bas et trois cas d’échecs, jusqu’à l’inhibition déjà évoquée.
L’affaire du Nicaragua et du Honduras illustre une réception favorable, un revirement et la nécessité d’une décision de la Cour internationale de justice (CIJ) plus de 50 ans après.
Les arbitrages rendus par des chefs d’États correspondent à une modalité de règlement des conflits de frontières à un moment donné, marquée par les incertitudes sur l’articulation d’un ordre juridique international. Des échecs retentissants et la critique doctrinale de ce type d’arbitrage (en 1924, le juriste grec Politis le qualifie d’archaïque) contribuèrent à chercher de nouveaux mécanismes qui ne sont donc pas le produit d’une évolution, mais plutôt d’une rupture.
N.C. : Au-delà du règlement d’un litige, les arrêts rendus par la Cour internationale de justice ont une portée politique et symbolique importantes.
L’ouvrage recense des cas de différends territoriaux dont le règlement par la Cour « p[eut] avoir des conséquences considérables pour les Parties », comme l’a relevé le juge Gevorgian dans l’affaire de la Sentence de Paris (Guyana/ Venezuela) (voir p. 186).

Cet enjeu est clairement perçu par les responsables politiques : par exemple, dans l’affaire de l’obligation de négocier un accès au Pacifique, « la procédure devant la Cour fut suivie de très près par les médias, l’opinion publique et la classe politique [en Bolivie].
En particulier, la délégation bolivienne devant la Cour, par ailleurs très nombreuse, comprenait la présence du président Evo Morales Ayma lui-même, qui a assisté personnellement à toutes les audiences orales relatives à cette affaire » (voir p. 148).
Compte-tenu des enjeux de souveraineté en cause, les arrêts ne sont pas toujours accueillis favorablement par les États dont ils contrarient les intérêts.
Par exemple, dans l’affaire de la Sentence de Paris (Guyana/ Venezuela), le Venezuela n’a cessé de manifester son refus d’accepter le règlement du différend par la Cour, faisant preuve d’une présence « fantomatique » lors du procès et accueillant l’arrêt de 2020 par de vives contestations, considérant que la décision a « de graves conséquences (…) pour sa souveraineté » (voir p. 204).
Cependant, l’ouvrage présente aussi des cas où les décisions de la Cour ont été exécutées par l’État dont les demandes ont été rejetées, comme le Nicaragua qui s’est entièrement exécuté de la somme qui avait été attribuée par la Cour au Costa Rica dans l’arrêt du 2 février 2018, fournissant un exemple d’exécution exemplaire d’un jugement international (voir p. 146).
Comme vous le soulignez à la page 61, “Soumettre les différends au jugement d’un État tiers fut une des solutions encouragées par la doctrine dans un contexte de pacification des relations internationales.”. Dans ce cadre, pourriez-vous revenir sur les motivations du choix stratégique qui a conduit la Guyane française et le Brésil à désigner le Conseil fédéral suisse comme arbitre dans leur différend frontalier, l’un des cas analysés dans votre ouvrage ?
Claire de Blois (C.D.B.) qui a étudié la question dans l’ouvrage collectif : Le choix du Conseil fédéral suisse par la France et le Brésil est le résultat de plusieurs décisions.

En premier lieu, les deux États devaient choisir entre un tribunal arbitral, composé des représentants de plusieurs États, et un arbitre unique.
La France a, en premier lieu, indiqué sa préférence pour un recours à un tribunal arbitral, convaincue qu’elle aurait davantage d’influence sur cette instance.
Suivant le même raisonnement, le Brésil a privilégié l’arbitre chef d’État, qui saurait davantage rester impartial. Il avance comme argument l’urgence de la situation et la lenteur qu’entraînerait la constitution d’un tribunal arbitral.
Il rappelle également que l’arbitre unique est privilégié par la communauté internationale dans les procédures de délimitation frontalière. La France finit par accepter cette configuration.
Restait ensuite à choisir l’identité de cet arbitre. Dès le départ, le Brésil propose le gouvernement de la Confédération helvétique. Là encore, il s’appuie sur la pratique internationale, qui fait de la Suisse l’arbitre privilégié des « nations civilisées ». Malgré quelques réticences, principalement en raison du nombre d’affaires confiées à la Suisse, ce fut finalement le choix retenu.
Dans un contexte marqué par la sensibilité politique du différend et la dispersion des sources – géographiques, juridiques ou encore historiques – comment le Conseil fédéral suisse a-t-il articulé son rôle d’arbitre avec la nécessité de reconstituer une base probante solide et légitime aux yeux des deux parties ?
C.D.B. : Conformément à la convention d’arbitrage, le Conseil fédéral a adopté une méthodologie associant l’étude des mémoires des deux États à des recherches complémentaires. Il a notamment sollicité à plusieurs reprises des éclaircissements aux deux parties, mené ses propres enquêtes et mobilisé des sources qui n’avaient pas été évoquées par les parties.
L’arbitre s’est en premier lieu appuyé sur le traité d’Utrecht, seul texte reconnu comme valable par les deux États, en écartant la convention de Paris de 1817. Cela lui a permis d’affirmer une base juridique commune.
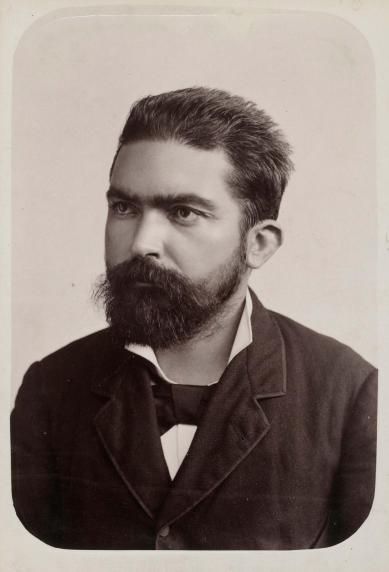
Pour construire sa décision, la Suisse a mené une double enquête : d’un côté, une recherche historique approfondie, à travers les traités anciens, les récits de l’époque, les correspondances diplomatiques ; de l’autre, une analyse géographique et cartographique détaillée.
Elle a aussi consulté les travaux de géographes français et étrangers, et examiné les cartes anciennes et modernes, notamment celles d’Henri Coudreau, qui soutenaient la position brésilienne.
Face aux imprécisions françaises, notamment l’incapacité à identifier clairement le cours d’eau revendiqué, ainsi que des cartes contradictoires, la Suisse a jugé la position brésilienne plus cohérente.
L’identification du fleuve Vincent Pinçon à l’Oyapoc, soutenue par plusieurs géographes français, a été décisive.
Concernant la frontière intérieure, la Suisse a privilégié une délimitation naturelle de la ligne de crête, conforme à la pratique internationale, plutôt qu’une frontière artificielle fondée sur un parallèle. Elle s’est appuyée, en outre, sur la présence humaine effective, constatant que les territoires concernés étaient majoritairement occupés par les Brésiliens.